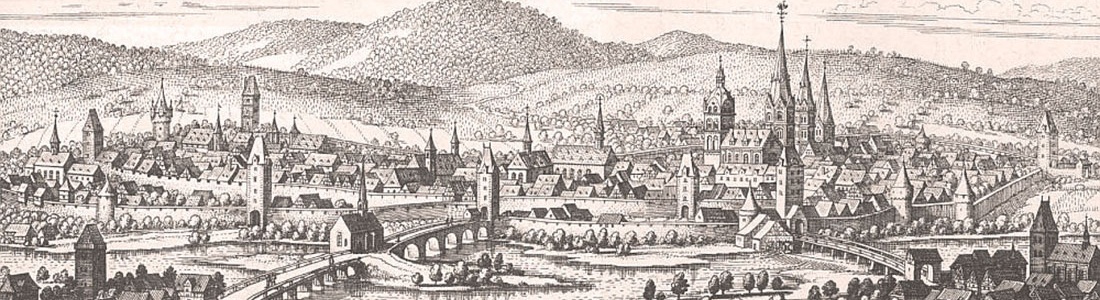HA.VI. Nachl. C.H.Becker. Rep.92 B. Nr.6407
421. Pierre Bertaux an C.H.B. Paris-Sèvres, 25.5.19281
Monsieur le Ministre,
Sans aucune hésitation je vous aurais imposé mon mauvais allemand, si je n’avais été pris de honte devant vous qu, sans être spécialiste, possédez si bien notre langue, et, mieux, l’esprit de notre langue. Vous auriez dit assurément que j’avais bien mal mis à profit mon séjour à Berlin, et pourtant je crois qu’il m’a été utile à beaucoup de points de vue. J’ai vu beaucoup de choses que je ne soupçonnais guère, rencontré nombre de personnes très intéressantes, mais d’après les rares occasions que j’ai eues de vous rencontrer, je suis sûr que c’est vous seul qui auriez pu me donner certains éclaircissements dont je suis très curieux, certaines clefs; mais on n’ose prendre sur le temps d’un ministre, encore moins d’un ministre tel que vous. Mais ces rares rencontres n’avaient fait pressentir que je pouvais entendre de vous avec fruit certaines choses, que par conséquent un certain – et très bel-humanisme qui rattache les intellectuels des pays différents, mais qui rattache aussi les jeunes générations aux aînées, est possible, et même se réalise. Certaines choses ne seraient-elles pas expliquées par ce fait que les jeunes Allemands ignorent les anciennes générations, plus encore qu’ils ne se dressent contre elles ? Je sais que cela a bien d’heureux résutats, ne serait-ce que celui-ci : lorsque par hasard ces jeunes gens découvrent un ‘ancien’, ils l’arrachent à son temps, lui prêtent de leur vie, font de lui leur contemporain : tel Georg Büchner, que j’ai découvert une seconde fois à la bibliothèque de l’Ecole Normale. Je suis heureux de voir se créer à cette Ecole une atmosphère de curiosité sans frontières qui me plaît; et j’ai piloté récemment et présenté aux camarades quelques représentants de la «Jugendbewegung» actuellement en tournée à Paris. Je me suis fort bien entendu avec eux; entre nous les dissentiments, quand il y en a, sont moins grandes que ceux qui nous séparent de personnes qui ont pour elles l’autorité de leur nom, de leur âge, de leur situation. J’ai cru m’en apercevoir récemment à Berlin, dans une discussion avec un Allemand qu’un beau dédain de la vulgarité amène à mépriser tout internationalisme des masses, et le cosmopolitisme. Il voulait réserver le contact de peuple à une élite intellectuelle – au nombre de laquelle j’étais flatté de m’entendre compter, sans que cela puisse changer mon opinion – et pensait, que je, pour arriver à l’inter=nationalisme, il faut partir du nationalisme, qu faut craindre par dessus tout de perdre ses qualités nationales, donc qu’il faut s’efforcer d’abord et pour longtemps de les cultiver exclusivement dans la masse, de les porter à leur perfection. Sans nier pour ma part la vertu des qualités nationales, j’ignorais qu’elles fussent chose si fragile, qui se laisserait si facilement effacer, et qui ne supporte pas le contact de l’air extérieur.
J’espérais vous voir avant mon départ; j’aurais été très heureux, en prenant congé de vous, de vous dire ma reconnaissance de ce que vous avez fait pour moi et de votre sympathie, et de la gratitude que j’ai à l’Université de Berlin de son charmant accueil. Malheureusement j’ai été rappelé par ma mère souffrante, et j’ai dû quitter Berlin dans les vingt-quatre heures. J’espère que vous ne m’en voudrez pas, dans ces conditions, d’avoir remis en Novembre ma visite, si du moins vous ne passez pas pour Paris d’ici là.
Je vous prie de me croire, Monsieur le Ministre, votre très respectueuse dévoué
Pierre Bertaux.2
422. Pierre Bertaux an C.H.B. Sèvres, 4.5.1929
Monsieur le Ministre,
Avent de partir, mes tentatives pour vous joindre, ne fût-ce qu’au téléphone, ont été vaines; j’étais désolé de quitter Berlin sans vous avoir revu, mais ainsi en avait décidé le Landtag.
Arrivé ici, je me suis occupé du séjour de votre fils en France; voici ce que dès à présent j’ai trouvé pour lui:un de nos amis, qui fut mon professeur, Monsieur Travers, accueillerait volontiers votre fils. Monsieur Travers est professeur de langue et de littérature anglaise au Lycée Louis-le-Grand et à la Sorbonne: il habite à Versailles une jolie villa avec un jardin très agréable. Déjà d’un certain âge, Monsieur Travers a trois enfants, un fils marié qui ne vit plus à Versailles, et deux filles, qui toutes deux enseignent, et vivent avec leur père ; elles sont vives, sympathiques, et je suis persuadé qu’elles seraient d’un grand secours à votre fils, puisqu’il veut apprendre le francais en la parlant.
M. Travers est un esprit profondément distingué, et d’une immense culture, ponctuée d’une ironie parfois mordante ; votre fils, s’il aime à discuter, aura affaire à forte partie.
Pour ce qui est du prix de la pension, M. Travers donnerait tous ses soins à votre fils pour 2.500 francs (environ 400 M) par mois ; il n’a pas l’habitude de prendre des pensionnaires, et il s’y est résolu cette fois sur la prière de mon père ; mais son dévouement m’est bien connu, et je sais qu’il aura à cœur de faire tout pour que votre fils fasse son séjour à Paris dans les meilleures conditions.
Si votre fils venait pendant le mois de juillet, je me ferais un plaisir, vous le savez, de m’occuper de lui tout au moins pendant la première quinzaine ; Versailles est à vingt-cinq minutes de paris, et je suis à mi-chemin.
Au cas où cela ne vous conviendrait pas, dites le moi simplement, et je chercherai autre chose.
N’accompagnez-vous pas votre fils, ne serait-ce que pour deux jours ?
J’attends votre décision ; je suis cher Monsieur et Ami, votre très respectueusement dévoué Pierre Bertaux.
423. Pierre Bertaux an C.H.B. Sèvres, 6.11.1929
Monsieur le Ministre,
L’automne cette fois ne me ramènera pas à Berlin, la Sorbonne va me garder cet hiver, ce printemps, jusqu’au mois d’août prochain où je passerai l’agrégation.. Mais je suis très occupé à recréer autour de moi l’Allemagne, l’Allemagne vivante cède seulement pour que temps la place à l’Allemagne éternelle, et si je dois renoncer à vous voir, c’est votre collègue Wilhelm von Humboldt qui en est directement cause, et son ‘Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen’. J’abandonne provisoirement Hölderlin:mon étude sur ‘Empedokles’ a eu à la Sorbonne un succès in espéré, et j’étais très satisfait de cette consécration universitaire de mes années à Berlin. Maintenant Goethe, Humboldt, les lyriques romantiques, Nietzsche, Wagner vont occuper mon temps.
Avant une année qui s’annonce dure, j’ai pris des vacances mouvementées, et qui furent riches en expériences. Cela a débuté par un pèlerinage à St.Jacques de Compostelle. Croyez bien que je l’ai fait pénétrer d’un profond sentiment religieux, sentiment qui ne fut pas le moins du monde entamé, bien au contraire lorsque j’appris de Miguel de Unamuno que les reliques vénérées étaient celles de l’hérétique Priscillien ! 2000 kilomètres de routes seules avec Dieu, les Espagnols, et les paysages, les plus nobles de l’Europe occidentale, enfin la splendeur de Santiago de Compostela, m’ont convaincu que l’Eglise catholique fut jadis la plus puissante et la plus astucieuse organisation de tourisme qui soit – et si je devais en ma vie ne faire qu’un voyage, je crois que c’est celui-là en effet que je ferais.
Une autre excursion en Espagne, non plus en auto, mais à pied dans les montagnes de l’Aragon, m’a révélé l’existence de cette vertu qui se nommait autrefois hospitalité et je fus ému d’être traité en frère par les montagnards de la province de Huesca.
J’eus aussi ces vacances des divertissements plus intellectuels. Pierre Viénot vous a certainement parlé de cette organisation amusante, hybride de monastique-mondain et de littérature que sont les décades de Pontigny. Mais c’est précisément en cet endroit que, songeant à ce que vous me disiez il y a deux an, je me sui senti bien peu intellectuel.. Car les 6000 kilomètres que j’ai parcourus en France et en Espagne et quelques heures avec des amis ici et là m’ont laissé les souvenirs les plus chers de ces vacances.
J’espère que votre fils s’est plus à Lausanne où vous vouliez l’envoyer. S’il prenait fantaisie d’essayer en France le francais qu’il vient d’apprendre je compte que vous n’oublierez pas de m’en prévenir. Mais vous-même, n’ose-t-on espérer qu’un jour…… ? Ce serait mon seul espoir de vous voir d’ici quelque temps, car il me faut renoncer pour deux ans sans doutes à contempler le feu de bois de votre cheminée.
Croyez bien, en tout cas, Monsieur le Ministre, que je garde fidèlement les anciens souvenirs, et que je suis et serai votre très profondément et respectueusement dévoué Pierre Bertaux.
424. Pierre Bertaux an C.H.B. Sèvres, 11.11.1930
Monsieur le Ministre,
Il me devient d’autant plus difficile de vous écrire qu’il y a plus longtemps que je me promets de le faire, et plus de chances pour que vous m’ayez complètement oublié.
L’année dernière a été dure. J’ai préparé l’agrégation, que j’ai heureusement passée en juillet, mais qui ne m’a laissé aucun loisir. Par ailleurs j’ai été secoué assez durement, et je songeais quelquefois à vous, à cet état que vous critiquiez, dont je ne sais s’il existe vraiment, où la faculté de sentir et de souffrir est abolie au profit de l’intellect – et cet état me paraissait désirable, et bien lointain. Une de ces épreuves a été une vive amitié pour un jeune étudiant berlinois, Gerhard Metz, intelligent, cultivé vraiment, délié, d’une sensibilité extrême, d’une grande richesse de cœur, et que je n’ai pu empêcher de se suicider. C’était chez lui une hantise maladive, qu’il connaissait pour telle, et contre laquelle, un jour où je ne me trouvais pas là, il n’a pu résister seul. J’ai u faire pour lui mort ce que je n’avais pas réussi à faire avant; j’ai tâché de rendre ainsi à l’Université allemande un peu de ce qu’elle a fait pour moi.
J’avais les nerfs à bout au mois d’août, quand nous sommes partis pour de longs voyages. Ces années-ci, nous avons traversé l’Espagne un peu dans tous les sens avec ma petite voiture ; je me suis fait des amis que je compte parmi les meilleurs chez les montagnards aragonais ; j’ai vu de palmiers d’Elche. Sentimentalement, l’Espagne m’attire plus directement que l’Allemagne. C’est un pays de vacances, où la vie est merveilleusement simple, sans problèmes.
Au retour, j’ai commencé mon service militaire. Il m’a été possible d’échapper aux exercices, que j’apprécierai, plus s’ils étaient franchement physiques, et de me faire nommer à Paris dans un bureau. Cela me permet d’avoir une vie normale, civile, libre, et de m’informer un peu sur les choses d’Allemagne qui, malgré tout, font mon véritable intérêt. Je réserve pour l’année prochaine le travail scientifique, une thèse sur Hölderlin, et j’essaie de me mettre un peu au courant des questions politiques et économiques.
Cela vous permettra de voir combien je suis peu militaire :je me préoccupe d savoir ce que je deviendrai, ce qu’on fera de moi, ce qu’on fera de notre pauvre Europe. Je m’aperçois qu’il faudrait savoir bien des choses pour réaliser mon ambition, de vivre vraiment en être conscient qui, s’il ne peut pas grand chose sur ce qui se passe, connaît du moins ce qui se passe.
J’ai beaucoup entendu parler de Monsieur Massignon par un de ses élèves, un ami de l’Ecole Normale, arabisant, qui a beaucoup d’admiration pour son maître. Cela me faisait souvenir de tel jour, au coin de feu, à Unter den Linden.
Vous avez dû apprécier d’avoir enfin des loisirs. Cela ne vous permettrait-il pas de passer en France ? Je pense que que j’en serais prévenu par mon ami Pierre Viénot, et je ferais alors l’impossible pour me mettre sur votre passage.
Il m’est interdit de passer la frontière d’ici un an : j’accompagne de mes vœux et de mes regrets ceux de mes amis qui vont à Berlin, dont j’ai quelquefois la nostalgie – chose que les Berlinois, je ne sais pourquoi, ne veulent pas comprendre.
Excusez-moi, Monsieur le Ministre, de m’être rappelé à vous, et de l’avoir fait si tardivement. Peut-être cela me vaudrait-il mon pardon si vous saviez combien sont présentes les marques d’amitié que vous avez daigné m’accorder, et combien je vous suis resté très profondément et très respectueusement dévoué. Piere Bertaux.3
425. Pierre Bertaux an C.H.B. Sèvres, 26.( ?)7.1931
Monsieur,
Il est difficile de vous écrire. Ou me suis-je rendu, par exigence; la tâche plus difficile qu’elle n’est?. N’importe, je me lance à la nage.
Ma candidature à la Fondation Thiers a abouti. Le vivre et le couvert – dans un hôtel particulier du quartier de la Muette – me sont assurés pour trois ans. Il me semble avoir trompé moins encore que je ne croyais le Conseil en lui affirmant mon impatience de me mettre au travail, et de poursuivre mes recherches. Il me semble décidément indispensable, avant toute vie active, d’être, ou plutôt de devenir quelqu’un, conscient de soi et calme, et ma voie, pour aller à cela, est encore celle des travaux scientifiques. Je dirai, avec l’esprit d’acceptation de certains Allemands: «Es ist nun einmal so», cet ordre de préoccupations est la plus capable de m’absorber et de me satisfaire. La façon dont je m’y engage me fait espérer d’ailleurs que je ne serai pas toujours un contemplatif. Dans trois ans, et même d’ici là, je ferai ce que je voudrai, et avec d’autant plus d’autorité, de facilité à être satisfait que j’aurai déjà derrière moi quelque chose comme ce «Hölderlin» dont je rêve.
J’ai agité beaucoup cet ordre de réflexions, la semaine dernière, en allant dans les Ardennes, passer quelques jours avec notre ami Pierre Viénot. Je venais d’apprendre la mort de Gundolf. J’avais emporté votre livre sur l’Islam, pour en continuer la lecture, qui en sera achevée, il serait présomptueux de dire bientôt, mais un jour certainement; car sans doute, j’avais tout à apprendre sur l’Islam, mais il restait encore dans mon attention une petite place réservée à l’auteur du livre. Il n’ est pas nécessaire de préciser comment, de là, je passais à des réflexions sur ma propre existence.
Mais la vie même de Viénot m’a confirmé dans ma façon de voir. Je crains beaucoup pour lui – me permettez-vous cette confidence? – qu’il ne souffre, aujourd’hui déjà et bientôt plus encore, de n’avoir pas de métier, de manquer de cette assiette que donne la possession d’une technique où l’on est maître. Grâce à sa force de caractère, et, je pense, à l’appui de sa femme, il surmontera ce risque. Mais je suis moins sûr de moi que de lui. Ce n’est pas un métier que d’être un homme intelligent, et, je craindrais de devenir un «Jack-of-all-trades», bon à tout, propre à rien.
Je vous demande pardon, mais votre sympathie vous attire ces confidences, ces annonces de résolutions que d’ordinaire je garde pour moi. Votre sympathie, et la chaleur de votre présence. Si peu que nous nous soyons vus cette fois, cela m’a donné beaucoup d’élan, un élan qui n’est pas encore épuisé, et que votre lettre est venue renouveler. Je suis extrêmement content de vous savoir à Paris l’hiver prochain pour quelque temps ; je serai moi-même là, et libre d’organiser mon temps a ma guise. Je vous en consacrerai – tout ce qui ne vous encombrera pas.
Car, quel que soit l’effort pour arriver en peu de temps à l’intimité, et peut-être à cause de cet effort, on n’évite guère quelque chose de tendu, dans la confiance même – quelque chose de tendu, que j’aime voir se dissiper – peut-être par un condamnable goût de la mollesse et de l’abandon; mais je ne m’inquiète pas trop de ce que je trouve en moi de condamnable. Je fonde de grands espoirs sur ce mois de Février.
Chose curieuse, quelques jours après votre départ, j’entendais par hasard (par un quelconque camarade de bureau fils de journaliste) d’une mission pédagogique en Chine, à laquelle un certain Monsieur connu était fort désireux de participer. Peut-être s’agissait-il de la vôtre. Bien que cela n’ait pas marché pour moi, cela m’a permis d’espérer qu’un jour peut-être des occasions semblables se représenteraient – encore que je doive probablement regretter toujours cette admirable et unique conjonction: vous – et la Chine. Je devrai remplacer cela par un petit voyage en Allemagne d’une quinzaine de jour, mais vous serez loin.
Mon père vient de faire des conférences à Cologne, Marburg et Leipzig ; il a même passé quelques heures à Berlin, just au moment de la crise. Je l’enviais beaucoup de n’être pas militaire, et de pouvoir circuler ainsi. Je me suis contenté de suivre d’aussi près que le permettait la presse, et avec une grande émotion, les événements récents. Le sentiment de l’impuissance où l’on est paraît quelquefois pénible, et on serait tenté de se cantonner dans des spéculations à plus longue échéance ou plus abstraites. Mais je crois qu’une organisation de l’existence un peu subtile – témoin la vôtre – permet de mener tout de front, et de plus de réaliser quelque chose.
En me relisant, je trouve que je n’ai pas du tout dit ce que je voulais, et je suis convaincu de ma maladresse dans l’art épistolaire. Veuillez me la pardonner, et senti seulement sous la gaucherie une profonde et respectueuse affection, qui se traduit par beaucoup de confiance et de bonheur. Votre très dévoué Piere Bertaux.4
426. Pierre Bertaux an C.H.B. z.Z. in Ferien in Lescur, 10.8.1931
Le mot ‘Monsieur’ n’avait pas été placé là étourdîment. Mais une règle – dont je saisis pas très bien les motifs – veut qu’une lettre commence et finisse, comme si chaque fois on pouvait envoyer un « Paquet » achevé de pensées, ou comme si c’était un genre littéraire aussi rigide que le sonnet. S’il faut respecter la convention, je pusse le respect jusqu’à vous écrire « Monsieur », songeant d’ailleurs qu’on a bien tort de se gausser des Jansénistes, qui arrivaient, après quarante ans de fréquentation journalière, à une probablement bien grande intimité, et se donnaient du « Monsieur » au dernier jour comme au premier. C’est là d’ailleurs une expression simple, correcte, de bon goût, et qui ne préjuge en rien des sentiments. C’est à cela surtout que je tenais.
Naturellement je serais extrêmement heureux si vous aviez la bonté de me porter sur la liste de vos amis. J’aurais ainsi un peu le sentiment que je vous accompagne. Cela m’inciterait aussi sans doute à vous écrire, – ce que je ferai certainement de toute façon. Si même quelque chose devait me retenir de le faire, j’aurais une raison décisive de vous écrire: la crainte de perdre votre faveur, qui m’est devenue tout d’un coup si précieuse.
Comme tous les ans, je suis venu à Lescur, retrouver des choses de la plaine une perspective cavalière, opérer des reclassements, des regroupements – ou plutôt laisser tout cela se faire pour moi, grâce aux vertus de l’altitude, des eaux et des roches. Le temps, pour l’instant, est humide et froid, il neige sur les hauteurs. On somnole devant le feu de bûches, en laissant passer les après-midi. Si ce temps continue, je passerai la frontière, j’irai chercher le soleil sur le versant espagnol. Je rentre à Sèvres le 22 Août; vous n’avez pas songé à prendre le bateau à Cherbourg? Je quitterai le service fin septembre, et m’installerai à la Fondation Thiers pour trois ans. Voici les cadres de mon existence. De quoi sera-t-elle faite elle-même? Gardez et promenez autour du monde, le souvenir d’un ami très fidèle et très ardent, et croyez bien que de tout cœur je vous accompagne – même s’il m’arrive, d’une façon ou de l’autre, de vous dire «Monsieur». Votre Pierre.
427. Pierre Bertaux an C.H.B.
Paris XVIe, 5, rond-point Bugeaud, 29.20.1931 Fondation Thiers
Bien cher et grand ami –
Votre carte m’a fait un extrêmement grand plaisir, en arrivant en même temps que les deux premières parties de votre relation de voyage. Autant j’étais heureux de vous suivre dans les péripéties de votre tour du monde, auquel je regrette bien de ne pas avoir participé, autant cela m’a touché que vos amis gardent pour vous, si loin, leur »présence réelle». C’est encore ce vieux mot des mystiques qui rend le mieux le sentiment qui se rit (?) des distances, et passe les océans sans rien perdre de sa chaleur. En ce moment, j’ai plusieurs amis sur les mers, l’un entre Amsterdam et Hambourg, l’autre entre Bordeaux et Lisbonne, un autre encore entre Marseille et Montevideo. Les liens de mon amitié semblent se tisser sur le globe, et reconstruire le monde à mon usage, qui sait? Peut-être m’arrivera-t-il un jour prochain d’explorer moi-même « mon » univers, celui qui s’est pour moi recomposé.
Pour l’instant, je me suis installé dans ma nouvelle demeure. Il est étrange de sentir venir le moment de quitter ceux avec qui l’on a le plus vécu – sans que soit diminuée en rien l’affection, sans qu’autre chose de plus tentant vous attire – simplement parce que l’on sent nécessaire une solitude au centre de laquelle on capte les radiations, d’où qu’elles viennent –où, peut-être aussi on puisse rayonner plus librement, agir tout autour de soi. Il est des combats qu’on doit livrer seul. Ceux qui sont chers ne peuvent être autre chose que des recours, des aides lointaines. Mais c’est là beaucoup déjà, le plus, sans doute, qu’on puisse faire entre hommes.
C’est une grave expérience que celle que je commence; il est dangereux, pour l’amitié, que d’habiter ensemble. Et pourtant huit jours ont passé depuis que je me suis installé ici avec Jean Baillou – nous sommes plus liés que jamais, après quelques batailles livrées – je vous conterai cela cet hiver – et il n’y a plus que la longue suite de temps qui puisse venir affadir notre affection, après les épreuves qu’elle a subies.
Matériellement, je suis très bien ici. Une cellule un peu, pas trop austère, beaucoup de commodités matérielles, l’existence assurée s’il n’intervient pas de cataclysme d’ici trois ans – et s’il y a la Révolution, je fonde ici le Soviet de Paris –Ouest. Pour l’instant, je suis exactement à l’une des extrêmités de la plus belle avenue du monde, qui va de Concorde à l’Etoile et à la Porte Dauphine. C’est à ce bout là que je me trouve, à 100 mètres du Bois de Boulogne, dans un bel hôtel de la fin du siècle dernier, composé essentiellement d’un immense escalier central, avec tout autour les demeures de quinze jeunes intellectuels, juristes, savants, philosophes, tous profondément absorbés par leurs travaux. Moi-même, je viens de reprendre Hölderlin avec la plus profonde joie de me sentir si souvent proche de lui. C’est en tout cas avec une respectueuse adoration que je l’aborde, et mon geste, bien qu’universitaire, n’aura, je l’espère rien de sacrilège.
Un de vos amis, Karl Gustav Gerold, est venu me voir avant-hier. Il a l’air extrêmement sympathique, bien qu’ayant besoin de voir où doit s’exercer l’esprit critique, dont il n’a – pas, soit pas encore les applications indispensables. Je ferai de mon mieux pour lui être utile.
Je vais aller voir Pierre Viénot la semaine prochaine. Nous parlerons de la situation générale, qui est plus que jamais passionnante, et dont j’ai suivi l’évolution d’aussi près que je le pouvais. Nous parlerons aussi de vous, cher ami, que j’espère bien voir longuement cet hiver à paris. N’oubliez pas que vous avez parlé de Février ; ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.
Mes parents se joignent à moi.Je sais que vous n’ignorez pas mon affection. Je sais que vous ne m’oubliez pas. Que faut-il de plus? Peut-être vous dire merci, et faire des vœux, de tout cœur, pour la suite de votre voyage. Pierre.
428. Pierre Bertaux an C.H.B. Paris, 29.11.1931
Un mot seulement, bien cher ami, pour vous remercier de votre correspondance, que je suis avec passion et regret. C’est avec une bien grande affection que je pense à vous, en des jours un peu difficiles, qui ont sans doute l’avantage de me rendre pour longtemps et tout entier à Hölderlin. J’ai fait ces derniers temps l’épreuve de ce qu’est l’amitié, qui est une bien grande chose. Nous nous sommes trouvés quatre …
C’est beaucoup. C’était une belle expérience, que de se trouver à toute heure du jour et de la nuit, quand l’un avait besoin de l’autre, ou des autres.
Il était normal qu’alors je pense beaucoup à vous, qui savez le prix des choses, avec une grande joie. Votre Pierre Bertaux.
429. Pierre Bertaux an C.H.B. Paris, 27.5.1932
Très cher ami,
Depuis plus d’un mois, j‘ en’ai pas écrit une seule vraie lettre ; je veux que la première soit pour toi.
Il est inutile que je te fasse un rapport détaillé de ce que j’ai fait depuis que nous nous sommes quittés ; et pourtant ces récits simples sont encore ce qui permet le mieux, peut-être, de garder le contact – un contact que je voudrais ne jamais perdre avec toi. Mais cette fois ci, l’essentiel est certainement la campagne que Pierre Viénot t’auras contée. Merci d’ailleurs des quelques mots que tu lui as dits sur ce qu m’a poussé à travailler avec lui. Certainement j’ai été amené à collaborer avec Pierre un peu par ambition, avec l’arrière-pensée qu’un jour je ferais ce métier pour mon compte. Mais c’est ce qui a le moins pesé dans mon choix. Il y avait assez d’autres choses. Sans parler de l’affection que j’ai pour Pierre et pour Andrée, – cet élément était le plus lourd – il y avait le sentiment qu’il fallait aider le camarade ; c’était la première fois de ma bie que je «faisais équipe» – et je crois que l’équipe n’est pas mauvaise ; elle a en tout cas travaillé dans la joie, – la joie de se sentir travailler.
Et puis, et puis, c’était aussi la première fois que j’avais un contact véritable avec le peuple, et je me suis attaché à ceux que j’ai connus; – je crois que je me les suis attachés aussi, quelque bref qu’ait été le contact. Il y a des hommes admirables, parmi les militants socialistes.
Je consens que ce ne soit pas entièrement leur faute (leur mérite) et que les circonstances de la vie les obligent à être admirables, tandis que nous autres pauvres intellectuels, sommes lourdement handicapés. N’empêche que c’est une grande satisfaction que de rencontrer des hommes.
Des hommes d’ailleurs qu’on ne peut prendre uniquement par les sentiments tendres, et qui souvent sont plus sensibles à l’autorité qu’à l’affection; qui veulent plus aimer qu’être aimés. (En quoi ils ont bien raison?)
Certes, c’est un service à rendre à ceux que l’on aime, que de se rendre indépendant d’eux, plus fort qu’eux ; ils vous sont plus reconnaissants de votre force que de votre tendresse.
Pardon du niveau tout élémentaire de ces considérations pour toi banales, pour moi neuves. S’il était besoin de me consoler de cette banalité, je me rappellerais que Hölderlin n’a écrit à 31 ans cette phrase, que je découvrais ce matin même :
„Ich meinte immer, um in Frieden mit der Welt zu leben, um die Menschen zu lieben und die heilige Natur mit wahren Augen anzusehen, müsse ich mich beugen, und, um andern etwas zu seyn, die eigene Freiheit verlieren. Ich fühle es endlich, nur in ganzer kraft ist ganze Lieb; es hat mich überrascht in Augenblicken, wo ich völlig rein und frei mich wieder umsah. Je sicherer der Mensch in sich und je gesammelter in seinem besten Leben er ist, und je leichter er sich auf untergeordnete Stimmungen in die Eigentliche wieder zurückschwingt, um so heller und umfassender muß auch sein Auge seyn, und Herz haben wird er für alles, was ihm leicht und schwer und groß und lieb ist in der Welt.“
Je te fais cette longue citation, pour t’amener ainsi à participer à ce qui me tient à cœur, à mon travail, et à te montrer comment tout ce que je fais se rejoint en moi, converge en moi et se compose. Quelques diverses que soient les occupations que l’on peut avoir, ne doivent-elles pas ainsi confluer, se trouver réduites à un commun dénominateur, qui est ce sujet de l’expérience ? Le mot d’expérience est dangereux; il pourrait faire croire à un désir d’expérimentations curieuses ; mais tu sais qu’il s’agit de «Erlebnis».
Je me laisse entraîner à ma pente, et je disserte, je raconte, je bavarde ; mais je ne sais rien qui soit plus immédiatement moi, rien que je désire plus te livrer, que quelques réflexions – quelques prises de conscience.
Depuis que je suis revenu de Ronoi, je me suis enfermé, retiré, replié sur moi-même. Je veux résister à la terrible dispersion qui nous guette. Je ne vois que quelques amis, les meilleurs, et peu – j’ai entendu deux concerts, en particulier Kreisler – j’ai surtout vécu avec Hölderlin. Je veux écrire à ton ami Rommel dès que j’aurai lu sa brochure, d’ici quinze jours je pense ; mais il ne sera plus à Heidelberg. On lui fera suivre son courrier ?
Quelques journaux m’informent très mal de ce qui se passe en Allemagne ; il semble qu’on doive être très inquiet. Je pense voir Pierre bientôt, qui me dira ce qu’il aura vu.
Bien cher ami, je songe aux jours passés ensemble à Paris, si agités et si denses. Il est vrai qu’ils ont été courts, et placés en ces bizarres circonstances. Veux-tu me croire toujours très affectueusement tien?
Et présentez mes hommages à Madame Becker, et me rappeler au bon souvenir des tiens?
Et grand merci de l’accueil fait à mon père.
Ton Pierre Bertaux.
430. C.H.B. an Pierre Bertaux, Fondation Thiers Berlin (?), 22.6.1932
(Maschinenkopie)
Lieber Freund!
Heute erhältst Du keine Antwort auf Deinen wundervollen, freundschaftlichen Brief, auf den ich Dir lieber mit der Hand persönlich antworte. Heute nur eine ganz technische Anfrage. Kennst Du vielleicht irgedeine gute französische Familie, die für die Monate August, September, Oktober, einen älteren deutschen Studenten aus erstem Hause aufnehmen würde? Es kämen etwa 200 RM Pension pro Monat in Frage. Es kommt ihm hauptsächlich auf Familienanschluß an, da er für künftigen Bankdienst nach Abschluß seiner Studien die modernen Sprachen beherrschen muß. Englisch spricht er bereits perfekt. Bemühe Dich nicht, wenn Dir nicht gerade etwas einfällt. Es ist ein netter Junge; er heißt Wolfgang Sintenis.
In herzlicher Zuneigung, wie stets Dein getreuer C.H.B.
431. Pierre Bertaux, Fondations Thiers. Paris, 10.7.1932
Cher ami,
Ceci est également une lette toute pratique : Certainement ton ami qui cherche une famille française trouvera quelque chose – s’il n’a encore rien sous la main, je peux lui recommander un mien ami, Philippe Wolf, jeune imprimeur de 22 ans, très intelligent et cultivé, que j’aime beaucoup et qui le recevrait dans les conditions suivantes.
Philippe habitera en Août et Septembre tout au moins à la campagne avec sa femme et son fils (mon filleul) de trois mois, dans une maison qui appartient à sa mère, et qui est en lisère de la forêt de Montmorency, à 10 minutes d’une gare qui mène rapidement à St. Lazare. D’ailleurs sous les matins Philippe va en voiture à ses affaires, revient le soir, et transporterait ton ami.
Si Wolfgang Sintenis est intéressé, qu’il écrive donc à Philippe Wolf, 69 rue Brancion, Paris. D’ailleurs ils pourraient faire un essai d’un mois, et voir si cela leur convient.
Questions personnelles : je pars dans trois jours pour Lescur- Basses-Pyrénées, où je resterai jusqu’au 15 Août, puis je prends la route : Espagne et Portugal, jusqu’au 20 septembre. L’année ici s’achève très bien.
Pour cette histoire dont je t’avais parlé, après avoir été à peu près engagé pendant quelques semaines, nous avons rompu, et cette fois définitivement. Il n’y a plus à revenir sur cela. Je crois que la solution, pour négative qu’elle soit, est bonne – et je te l’annonce.
Songe toujours à ton ami très fidèle et affectueux. Pierre.
P.S.1. Je reçois un mot de Picht, qui donne signe de vie. Je dois lui téléphoner demain.
P.S.2. W.Sintenis voudrait-il écrire en anglais à Philippe W.?
432. Karte von Pierre Bertaux. Coimbra, Universität (P), Anfang September 1932
Merci beaucoup de ta carte, qui m’a joint à Porto. Un mois de montagne, et déjà quinze jours de route quotidienne – me voici pratiquement absent d’Europe depuis six semaines, et les mauvais démons sont à peu près chassés. Je pense à ceux que j’aime et qui m’aiment avec simplicité, et le poids des mots ne m’encombre plus, dans ma vie de sauvage.
Te verrai-je bientôt ? Si je vais à Berlin en Octobre, y seras-tu?
J’espère que tu me sais toujours ton très tendrement dévoué Pierre.
433. C.H.B. an Pierre Bertaux. Berlin (?), 9.9.1932
Maschinenkopie
Mein lieber Pierre!
Noch immer habe ich Dir nicht persönlich geschrieben und schon wieder komme ich mit einer Bitte. Ein Neffe von mir, Günther Becker, der Sohn meines jüngsten Bruders, ist zur Zeit in Paris, und ich würde so sehr gern haben, daß Du ihn kennen lerntest.
Es ist ein ungewöhnlich gescheiter, sehr musikalischer und auch persönlich sehr netter Mensch. Er studiert Chemie und steht vor dem Abschluß; er ist ungefähr gleichaltrig mit Dir, vielleicht etwas jünger. Ich höre erst jetzt, daß er in Paris ist, wo er sich nur für wenige Wochen aufhält, aber ich möchte ihm doch gern Gelegenheit geben, Dich kennen zu lernen, und Dich wird es vielleicht amüsieren, einmal jemand von meiner Familie zu sehen. Günthers Adresse ist die folgende: Société Anonyme d’Exploitation des Procédés Lurgi, Paris, Rue de Richelieu. Ich schreibe ihm mit gleicher Post, daß er sich mir Dir via Sèvres telefonisch in Verbindung setzt.
Mir geht es sehr gut; ich bin jetzt zurückgekehrt und schreibe Dir bald ausführlich.
Von Herzen Dein getreuer (C.H.B.)
P.S. Dieser Brief war noch nicht unterschrieben, als Deine Karte aus Portugal eintraf. Ich habe meinem Neffen sofort geschrieben, daß Du zur Zeit noch nicht in Paris seiest, daß er aber vor seiner Abreise doch noch versuchen sollte, Dich zu treffen. Ich freue mich von Herzen der schönen Ferien, die Du hattest und schreibe Dir nun wirklich bald persönlich.
434. Pierre Bertaux, Fondation Thiers an C.H.B. Paris, 19.10.1932
Bien cher ami,
Ceci n’est qu’un mot rapide: je pense aller à Berlin vers le début de mois Novembre, pour quinze jours à trois semaines – J’en suis très heureux.
Merci beaucoup de tes vœux, les seuls, avec ceux de mes parents, qui m’aient été exprimés. Je dois dire qu’ils n’étaient pas inutiles, car j’étais un peu consterné par la facilité avec laquelle on double le cap du quart de siècle.
Je travaille en ce moment, je vais à Berlin pour travailler – sans beaucoup d’enthousiasme, mais on ne supporterait pas une joie trop constante, sans doute.
Mais de tout ceci nous parlerons bientôt. J’aurais voulu te répondre en Angleterre, mais ne n’ai pu exactement déchiffrer ton adresse.
J’ai été désolé de manquer ton neveu à Paris, qui m’a écrit une lette charmante.
Très affectueuses amitiés, et à très bientôt. Ton Pierre.
435. C.H.B. an Pierre Bertaux. Berlin (?), 26.10.1932
Maschinenkopie
Lieber Freund!
Zwischen zwei Reisen kurz die Bestätigung Deiner beiden Briefe. Ich freue mich riesig, Dich vom 5. November ab für längere Zeit in Berlin zu wissen. Wir werden dann manche schönen Stunden zusammen haben.
Ich fürchte allerdings, daß ich Deinen Freund Roger Martin Du Gard versäumen werde, da ich heute für den Rest der Woche nach Hamburg fahre.
In aller Eile mit herzlichen Grüßen Dein getreuer (C.H.B)
436. Pierre Bertaux, Fondation Thiers, an C.H.B. Paris, 20.12.1932
Maschinenmanuskript
Bien cher et grand ami,
Un mot seulement, d’excuses, pour ne pas t’avoir écrit encore – et pour ne pas t’écrire encore cette fois – une vraie lettre.
Mon retour en avion a été excellent, un enchantement, une révélation. Ce n’est pas un voyage, c’est une courte promenade. Ce n’est plus rien que d’aller passer trois ou quatre jours à Berlin – plus rien, qu’une question d’argent.
Ayant eu si peu le sentiment de voyager, j’ai eu beaucoup plus le sentiment d’une difficile réadaptation à Paris, que décidément je n’aime pas. Pourtant, ce qui s’y passe est très intéres-sant, et en particulier les discussions politiques entre jeunes y ont beaucoup de niveau.
Je passe en général la journée seul dans ma chambre, le soir seulement je me mêle à la vie extérieure. J’ai l’intention d’essayer de finir mon travail en dix-huit mois ; c’est impossible, mais cela me pressera d’aboutir, et il est nécessaire d’aboutir vite.
D’ailleurs c’est encore sans doute la chose qui me tient le plus au cœur. Suis-je très indifférent ? Dur ? Ces nouvelles venaient-elles à un moment où je me concentrais sur cet effort de réadaptation ? Au fond, je n’ai eu qu’un choc nerveux et physique en apprenant deux nouvelles : cette jeune fille dont je t’avais parlé, qui était dans une clinique, en rentrant chez elle, provisoirement guérie, s’est tuée d’un coup de revolver. Et mercredi dernier, Denise Supervielle a eu une crise d’appendicite compliquée de péritonite ; on a dû l’opérer d’urgence ; on considère maintenant qu’elle est hors de danger.
Sais-tu que les cinq semaines que je viens de passer à Berlin m’ont profondément marqué ? Je m’aperçois maintenant en faisant le point. Je t’en parlerai sans doute.
Politiquement, le désordre est grand, et je me hâte d’en rire. Il n’y a pour l’instant rien d’autre à faire.
Vu l’ami Pierre, qui fait consciencieusement son métier. Pas encore parlé des questions marocaines et algériennes ; demain, sans doute.
Considère que ce mot est provisoire, arraché à l’instant, fais-moi confiance, et crois-mois toujours le même.
(Handschriftlich) Très affectueusement Pierre.
P.S. Sais tu que ta dédicace sur la conférence en italien m’a profondément touche ?
437. Pierre Bertaux , Fondation Thiers, an C.H.B. Paris, 6.1.1933
Bien cher ami,
En ce moment, je suis seul, et d’assez triste humeur. Aussi tu ne m’en voudrais pas d’être peu lyrique et peu bavard.
Depuis que je suis rentré, je me retranche de plus en plus dans ma solitude. Tu connais ma chambre ; je m’y enferme quelquefois quatre ou cinq jours de suite, presque sans mettre les pieds dehors. Je n’écris pas, j’ai une phobie du téléphone. Le résultat ne se fait pas attendre. Les amis commencent par se vexer, puis se décommandent, et déjà m’oublient. Comme je suis fort « menschenscheu », en ce moment du moins, j’en suis bien aise.
Il pèse une atmosphère de catastrophes privées et publiques ; où qu’on se tourne, des drames, des morts, des accidents.
Une seule chose heureuse: la carrière de Viénot, après sa brillante intervention à la Chambre, s’annonce aisée, rapide.
Ma carrière aussi s’annonce assez bien, si du moins j’arrive à sortir quelque chose de propre d’ici 18 mois. Aussi j’y travaille.
Viénot dit que la chose à faire, pour organiser ton voyage, est de t’adresser à Roland de Margerie, de façon à ce que ton voyage en Afrique du Nord soit convenablement préparé.
Veux-tu me rappeler au bon souvenir des tiens –(est-il nécessaire de formuler en ce jour de l’An les vœux que je fais tous les jours ?) –
et croire à mon fidèle affection. Pierre Bertaux
1 In Berlin bereitete Bertaux, später Germanistikprofessor in Paris, wohl seine Diplomarbeit vor, 1930 stellte er sich dem Concours d’agrégation, ein ziemlich hartes Auswahlverfahren für die Elite der Studenten. Nur die verfügbaren Stellen bestehen; es gibt auch Bi- und Tri-Admissibles, die sogar ein gesteigertes Gehalt erhalten – immerhin müssen sie sich ein weiteres Jahr vorbereiten. Ich unterrichtete in Bordeaux u..a die Licenciés in mittelalterlicher Literatur, die seit je auf dem Programm der Germanistik auf dem Niveau Agrégation steht.
2 Handschriftlich beantwortet in Marienbad 16.7.1928. C.H.B.
3 Beantwortet handschriftlich 25.1.1931. C.H.B.
4 Beantwortet 31.7.31